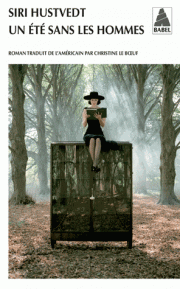|
Les internautes l'ont lu
Sans homme, et sans saveur…
Voici une histoire somme toute banale : une femme dont le mari entretient une liaison avec une maitresse plus jeune que lui se réfugie auprès de sa mère octogénaire, après que son mari lui ait demandé de faire « une pause » dans leur couple. Elle quitte ainsi tout à la fois l’homme avec lequel elle pensait finir sa vie, mais aussi New York, ville frénétique, pour se retrouver au fin fond du Minnesota, face à son avenir – qui lui semble plus qu’incertain- mais aussi face à elle-même. Ce texte d’ailleurs ressemble un peu à un journal, plus qu’à la narration classique d’un roman. Mia réfléchit à son parcours, reprend le fil de sa vie, ses souvenirs, retrouve l’élan de la poésie qui l’avait jadis portée, retrouve également l’angoisse et la peur ressenties lors d’un séjour en hôpital psychiatrique, des années auparavant. Ce voyage ressemble à une fuite, mais permet aussi à cette femme de se rassembler, de s’écouter, de réfléchir. Tout d’abord refermée sur elle-même, elle va tout doucement s’ouvrir aux autres, trouver en sa voisine une nouvelle amie, s’interroger sur la vie et les pensées des adolescentes à qui elle donne des cours de poésie et retrouver avec plaisir les amies de sa mère, veuves joyeuses qui portent sur la vie un regard tout à la fois empli de sagesse, dû à leur grand âge, mais aussi espiègle et libre que si elles avaient 20 ans. J’ai été très déçue par ce livre, qui m’a paru long à lire, et parfois vraiment fastidieux. Très étrangement, l’écriture est tour à tour tout à fait superbe, et à d’autres moments, le texte part dans des considérations littéraires, intellectuelles ou psy que j’ai trouvées totalement rasoirs et superflues… J’ai totalement adoré la relation de Mia et d’Abigail, la brodeuse secrète, de même que les descriptions des adolescentes, mais j’ai trouvé l’ensemble complètement inégal et au final la délicatesse et la beauté de certains passages pâtit à mon goût du coté intello-bobo-new-yorkais de l’auteur. Dommage. Sans les hommes
Mia a connu la folie. Plus exactement une « crise psychotique », aussi appelée « bouffée délirante ». Elle a visité les marges de la raison, où elle aurait pu sombrer après le départ de Boris, son scientifique de mari. Il ne l’a pas vraiment quittée, il a prononcé le mot « pause ». Ouais… « La Pause était française, elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d’étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de vingt ans plus jeune que moi, et j’ai dans l’idée que Boris avait convoité quelque temps sa collègue avant de donner l’assaut à ses régions éloquentes. »
Remise sur pied, Mia, poétesse auréolée d’un prix littéraire mineur, est engagée dans un atelier d’écriture suivi par sept adolescentes occupées à tester leurs capacités de séduction ou à effacer leur part féminine, à mener entre elles une furieuse compétition ou à nouer de passagères amitiés. Mia s’est aussi rapprochée de sa mère et de ses amies, dans un établissement pour personnes âgées où on ne s’attend pas à trouver autant de vie. Une voisine et sa petite fille complètent l’environnement d’Un été sans les hommes, vécu par contrainte – le choix de Boris – mais finalement pas si malheureux.
Bien sûr, certains moments restent douloureux. Mais le nouveau roman de Siri Hustvedt est l’histoire d’une cicatrisation réussie, pendant laquelle Mia devient plus forte qu’elle l’était. Elle trouve en elle et dans la proximité d’autres femmes, qu’elles soient en devenir comme ses élèves ou que leur espérance de vie soit réduite comme sa mère, assez d’arguments pour se reconstruire et montrer à sa fille Daisy ainsi qu’à sa sœur Bea un visage rassurant.
L’héroïne peste souvent contre la place réservée aux hommes dans la société, l’espèce de supériorité « naturelle » dont ils jouent comme d’un argument définitif. La différence se manifeste jusque dans les habitudes de lecture : « Si un homme ouvre un roman, il aime avoir sur la couverture un nom masculin ; cela a quelque chose de rassurant. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver à cet appareil génital externe si l’on s’immergeait dans des faits et gestes imaginaires concoctés par quelqu’un qui a le sien à l’intérieur. »
En revanche, quand il s’agit d’écriture, la narratrice refuse l’idée d’une écriture féminine, malgré ses propos féministes : « Moi, votre narratrice personnelle privée, je pourrais porter un masque, un pseudonyme. »
Ce n’est là qu’une des manières dont Siri Hustvedt installe la complicité avec les lecteurs. Au milieu du roman, il s’agit de les embrasser pour les remercier d’être encore là. A la fin, de déclarer qu’ils sont des amis. Cette familiarité l’autorise à donner son opinion sur quelques codes du récit : « La chronologie est parfois surestimée en tant que procédé narratif. »
Tout cela donne à un sujet pathétique, la femme larguée, l’allure d’une belle fête. Retrouver Pierre Maury sur son blog
|
|
|
|
|
|