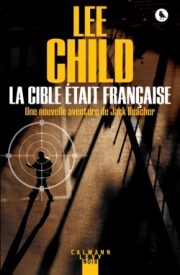Dr. Reacher et Mister Child
« Dans les librairies, les lecteurs demandent le nouveau Jack Reacher, jamais le nouveau Lee Child». C’est l’intéressé qui le dit et il le vit très bien. De son vrai nom Jim Grant, ce longiligne Anglais du Nord, New Yorkais d’adoption, incarne à 62 ans l’une des plus belles réussites du monde de l’édition. Les aventures de son justicier solitaire, montagne de muscle vivant sans attache, se vendent par millions, et pas seulement dans les boutiques d’aéroport. Deux de ses thrillers, bien que portés à l’écran paresseusement, avec un Tom Cruise peu convaincant, ont ajouté à la notoriété planétaire de ce héros à l’ancienne. Dans « La cible était française », 19ème de ses 21 romans, Jack Reacher traque entre les Etats-Unis, la France et l’Angleterre, un sniper qui semble en vouloir à notre président de la République. Recette immuable : pas de référence directe à l’actualité ni de message politique, mais une grosse surprise à la fin. Et surtout de la distance et des clins d’oeil. La marque de fabrique d’un auteur qui n’a d’autre prétention que divertir.
Vous avez créé le personnage de Jack Reacher à partir de rien, il y a un peu plus de 20 ans, après avoir perdu votre job à la télé. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
Lee Child. La colère. Colère pour moi-même et pour tous mes collègues qui avaient été virés. Colère aussi pour les millions de gens qui ont signé pour vendre leur loyauté et leur force de travail à un employeur et qui se retrouvent un jour dans cette situation. J’ai voulu que Jack Reacher soit le symbole de cette frustration, un homme assez fort pour nous venger. En littérature, je suis fasciné par les conflits, le plus grand de tous étant celui qui oppose David à Goliath. Mais pour moi, le bon, celui qui a le pouvoir de nous aider, c’est Goliath. Jack Reacher est la résurgence de personnages mythiques médiévaux, scandinaves ou grecs : l’étranger solitaire qui vient résoudre vos ennuis puis disparaît.
Pourquoi est-il américain, alors que vous êtes britannique ?
Un tel personnage avait besoin d’un cadre géographique vaste, de paysages sauvages. Dans le centre ou l’ouest de l’Amérique, on peut faire 800 kilomètres sans voir la main de l’homme, on peut rouler cinq heures pour aller acheter une bouteille de lait. Il y a quelques siècles, Jack Reacher aurait pu vivre en Europe mais aujourd’hui, elle est trop civilisée, il ne pourrait plus errer dans de grands espaces.
Comment ce mélange de chevalier et de cow boy solitaire peut-il rester d’actualité ?
Les gens se sentent malheureux face à la violence du moment, ils pensent toujours que c’était le bon temps vingt ans auparavant. Jack Reacher aussi peut être violent mais il a le coeur du bon côté, des valeurs éternelles qui rassurent. Il ramène les lecteurs à leurs vieilles certitudes, bon sens et bonnes manières. La fiction est là pour donner ce genre de satisfaction, pour apporter ce que l’on n’a pas dans la vraie vie.
Est-il davantage enquêteur ou homme d’action ?
Il faut une plus grande part d’enquête où il puisse appliquer son processus de déduction, c’est ce que les gens aiment. N’oublions pas que nous autres, « mystery writers », écrivons tous dans l’ombre de Sherlock Holmes. Un journaliste espanol a d’ailleurs joliment rebaptisé mon héros, qui vit sans domicile fixe, ni carte de crédit : « Sherlock Homeless »…
Est-il vrai que vous écrivez sans recherches préalables et sans plan ?
C’est vrai, je n’ai pas de plan, l’histoire avance d’elle-même et reflète la manière de penser du personnage. Le premier jet raconte les choses telles qu’elles doivent arriver. Je veux être à la même place que le lecteur, ne pas savoir ce qui va se produire. Si je le savais à l’avance, je m’ennuierais. Ce qui me surprend et m’excite doit aussi surprendre le lecteur, c’est la seule façon de créer du suspense. Un jour, un lecteur à qui je dédicacais mon livre m’a dit : « J’avais tout deviné dès la page 50 ». Je lui ai répondu : « Ah bon ? Moi pas ».
Un jour, Bill Clinton vous a cité parmi ses auteurs de thrillers préférés. A part les anciens présidents, qui sont vos lecteurs ?
C’est très large. Cela va, effectivement, de Bill Clinton ou du prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro, à des gens qui ne lisent qu’un seul livre par an, durant leurs vacances. Mais la majorité sont des femmes. Au début, je n’avais pas compris pourquoi, je pensais qu’elles voyaient en Jack Reacher un petit ami idéal. Pas du tout. Elles me l’avouent lors des séances de dédicaces : elles veulent être Jack Reacher, elles envient sa liberté, elles rêvent de tout lâcher, le mari, les gosses et la cuisine, pour partir comme lui sur la route, sans attaches. Elles me disent aussi ce qui ne va pas : elles n’ont pas aimé la fin ouverte de « 61 heures », où je laissais le lecteur tirer ses propres conclusions. Je ne le ferai plus.
Voient-elles en vous un peu de Jack Reacher ?
Je l’ai cru et c’était très agréable: ayant créé un « good guy », je devais en être un à leurs yeux. Mais beaucoup m’ont fait remarquer que j’avais surtout créé un paquet de méchants qui, tous, faisaient aussi partie de moi.
Voyagez-vous autant que votre héros ?
Pas autant mais j’aime bien découvrir des endroits perdus, anonymes. Tous ceux où il va correspondent à des voyages que j’ai faits un jour. Je les garde en tête et ils ressortent des années après. Peu importe où je me trouve quand j’écris. Je travaille surtout à New York, où je vis le plus souvent. Mais j’étais à Londres quand j’ai écrit la partie française de mon dernier roman. Et deux de mes romans sont nés en Provence, où nous avons aussi une petite maison.
Avez-vous toujours Jack Reacher en tête, comme si vous viviez avec lui ?
Je le maintiens à distance. Ce serait dangereux de trop penser à lui, des auteurs se sont perdus en aimant trop leur personnage, comme Thomas Harris avec Hannibal Lecter, par exemple. Les héros de polar actuels sont souvent trop dépressifs. Le mien est un héros à l’ancienne, heureux de son sort, il a de sérieux problèmes mais ne s’en rend pas compte. Par exemple, il est attiré par les femmes intelligentes qui, justement, pigent tout de suite que ça ne va pas marcher entre eux. Jack Reacher est parfait pour une aventure de deux jours. Après quoi il part et ne rappelle jamais, vu qu’il n’a pas de téléphone.
Vos romans sont très visuels : l’influence de votre culture télé et cinéma ?
J’aime la télé et le cinéma, mais si mes romans sont si visuels, c’est que je les conçois comme une réalité virtuelle : j’écris ce que je vois dans mon imagination. La télévision m’a tout de même appris à rythmer un récit, à ménager des « cliffhangers », ces fins de chapitres où l’action est comme suspendue dans le vide… Ça me vient naturellement. Et surtout, elle m’a appris à penser d’abord au public. Si je trouve une phrase cool qui me ferait passer pour un malin mais qui ne sert pas l’histoire, je la jette. Le lecteur d’abord. Je l’emmène en voyage et il doit se souvenir du paysage, pas du chauffeur.
Propos recueillis par Philippe Lemaire