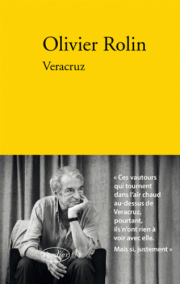|
La rédaction l'a lu
Du grand art !« Un jour de juin 1990, j’attendais au bar El Ideal, calle Morelos, une jeune chanteuse cubaine qui ne vint jamais (…) Une pluie furieuse, que le vent tordait comme une serpillière sale, battait Veracruz. » Une femme, un bar, une ambiance qui emporte aussi sûrement qu’un film avec Humphrey Bogart, et Howard Hawks ou John Huston aux manettes. Voilà pour les premières pages de cette nouvelle pépite d’Olivier Rolin. Comme dans « « Le Météorologue » paru en 2014, il y a une exploration littéraire autant que géographique à la clé pour l’écrivain aux semelles de vent. Ignace, Miller, El Griego, Suzana, les personnages s’enchaînent, les voix également, est-il question d’amour ? De trouver l’origine d’un début d’ivrognerie ? De s’interroger sur les liens qui unissent (serrent et, parfois, étouffent) les hommes et femmes entre eux ? De trouver un sens à la vie, aux rencontres manquées, au désir et à la passion, à l’envie irrépressible de possession de l’être aimé ? Ce court texte, ciselé de références, fait penser au « Bar des flots noirs » (du même auteur écrit il y a bientôt trente ans), qui mettait en scène un narrateur évoquant les femmes et les écrivains qui l’avaient marqué, hanté… Veracruz surprend à chaque chapitre. Un homme dans un bar qui attend, des récits qui s’enchaînent (écrits par qui ? Pourquoi ?), des scènes de sexe, de violence et d’attente et un tableau qui se dévoile peu à peu, comme en un lent travelling arrière. Du grand art.
Les internautes l'ont lu
Tragédie
Assis au bar El Ideal, calle Morelos, Veracruz, le narrateur attend. Elle ne viendra pas. Et il le sait. Il s’était rendu au Mexique pour une conférence sur Proust. C’est à la fin d’une soirée tequila qu’il vit apparaître « le feu follet, la gueule d’amour ». Autrement dit, la passion. « C’était un amour-faucon. Surprise et rapidité…étaient sa loi. » Sa disparition brutale sans autre forme de sevrage laisse un homme perdu, hébété, cherchant un sens à tout cela, observant « les cercles que décrivaient les vautours, leur vitesse, leur rayon, la façon dont ils se croisaient, s’enchaînaient l’un à l’autre ». Afin de comprendre. Mais, les signes ont-ils un sens ? Un jour, alors que le temps commençait à s’étirer et l’homme à se fondre dans l’alcool, il reçoit, par la poste, quatre récits. Qui les envoie ? Elle ? Peut-être un signe ? Trois hommes et une femme pensent et s’observent en silence. A travers leur monologue, nous entrons dans l’univers de la tragédie. A moins que, sans y prendre garde, nous y ayons déjà mis les pieds. Avant, je veux dire, dès le début. Le temps se resserre brutalement dans cette pièce étouffante. L’action tendue vers un seul but semble soudain figée. Deux mots transpirent : amour et mort. On entend au loin un ouragan qui se prépare, à moins qu’il soit déjà passé. On ne sait plus s’il est dehors ou s’il est là, rampant discrètement vers sa proie. La femme retient à peine un désir insondable de vengeance : « Me farder moi de leur sang, y tremper mes mains, mes mains si fines, aux doigts qui se recourbent comme des arcs, comme des dards de scorpions, me maquiller d’écarlate, me parer de leur vie finie, me souiller de leur mort- m’ont-ils assez souillée. » Qui est cette Erinye, ivre de sang et de fureur, cette « dévastation qui approche. » ? Quelle souffrance a-t-elle endurée, muette de douleur, pour cracher un tel venin de haine ? Est-ce cette femme qu’il a aimée ? Se peut-il que ce soit ses mots ? Les hommes la regardent, ivres de violence et d’envie. Ils la désirent infiniment, et se taisent. Qui sont-ils ? Quel crime innommable ont-ils commis pour susciter une telle fureur destructrice ? La tension dévore ce huis-clos étouffant. On sent l’imminence de la catastrophe. Elle est là, pèse de tout son poids. Impossible d’y échapper. La tragédie, vous dis-je… Le texte est d’une beauté époustouflante. Pour ma part, je l’ai lu et relu. C’est nécessaire. Il est court et dense. On ne s’en lasse pas. Et puis, il cache quelque chose, un message, peut-être le sens de cette passion : vient-elle se loger dans un « ordre des choses », est-elle une réalité qui s’est peu à peu, avec le temps, parée de fiction, une étoile filante venant d’ailleurs et n’allant nulle part ? Une rencontre dénuée de sens et qu’il est vain de chercher à comprendre, laissant le narrateur seul avec ses questions, terriblement conscient qu’ « il n’y aura jamais de paix. ». « Nous voulons toujours que tout ait un sens…. Nous nous épuisons à ce rêve de maîtrise au lieu de vivre tout simplement… Le monde se joue aux dés à chaque instant. Il est un kaléidoscope dont les éclats colorés se recomposent pour former de nouvelles figures. » La littérature tente alors de lui donner un ordre. Elle écrit le monde, le recompose, l’ordonne, essaie de le traduire avec des mots. Mais après coup et donc trop tard. « Ce que nous appelons le monde n’existe que comme une fable », les récits sont des mensonges qui proposent un sens et nous rassurent peut-être. Mais au fond, nous ne sommes pas dupes. On sait, sans le dire, que le moment merveilleux est passé et a disparu. A jamais. Retrouvez Lucia-Lilas sur son blog
coup de coeur
Rolin au sommet de son art
Que je me sois précipitée sur le nouveau roman d’Olivier Rolin relevait de l’évidence. Sans plus de surprise, j’ai été une fois encore envoûtée par sa plume, qui n’a rien perdu de sa beauté, loin s’en faut. Comme il sait si bien le faire, Rolin nous entraîne vers de lointaines contrées, dans cette ville mexicaine dont le nom est en lui-même déjà une invitation au voyage – je ne doute pas d’ailleurs qu’il ait pu être à la source de son inspiration. C’est ici une Veracruz âpre et brutale qu’il nous est donné de découvrir, habitée par des individus dénués de morale et du moindre scrupule. Le narrateur y a autrefois brièvement séjourné et connu une fulgurante passion amoureuse. De cette histoire ne subsistent qu’un souvenir évanescent ainsi que quatre récits qui lui étaient mystérieusement parvenus par la poste et qui évoquent – peut-être – la femme aimée. Le narrateur nous les offre, dans toute leur crudité, dans toute leur cruauté, faisant naître chez le lecteur une sorte d’effarement mêlé de répulsion. Ces récits dérangent, tant ils disent la noirceur de l’âme humaine. Mais ils le font dans une langue d’une si grande qualité littéraire, avec des mots à la consonance parfois si poétique, que le contraste en est saisissant. Arrivée au terme de ces quatre témoignages, qui relatent une même situation selon quatre points de vue différents, j’avoue m’être sentie perplexe. Où l’auteur voulait-il en venir ? C’est la dernière partie du livre qui allait m’éclairer sur ce point, pour donner une dimension soudain beaucoup plus vaste à ce livre et me permettre du même coup de retrouver ce que je trouve passionnant chez Rolin : son aptitude à développer une fiction tout en s’interrogeant sur les conditions de sa création et ce qui s’y joue de la place de l’écrivain. «La littérature est une tromperie sans fin», nous dit-il. Qu’est-ce qui peut nous empêcher de penser qu’une aimable jeune femme ait pu relater des crimes aussi sordides ? Certains «indices» invitent le narrateur à croire que la gracieuse Dariana en serait l’auteur… tandis que d’autres l’éloignent de cette pensée. Mais ces interrogations sont sans fondement, puisque l’auteur s’efface derrière son texte ; il serait vain de vouloir chercher à y déceler sa présence. Quelle réalité se cache au cœur de la littérature ? Et d’ailleurs, y en a-t-il une ? Quelle relation fiction et réalité entretiennent-elles ? «Veracruz, le Mexique, le monde, tout cela n’existe pas.» Le monde ne serait rien d’autre qu’«une flamme, une eau bouillonnante, un nuage dissipé par le vent, [qui] nous échappe[rait] d’autant plus qu’on cherche[rait] à le saisir.» Il serait bien présomptueux de prétendre lui trouver une logique ou un sens quelconque, voire de vouloir lui donner chair à travers des mots. Il y a vingt ans, pourtant, la réponse de Rolin était tout autre : le monde, l’écrivain l’inventait ; il en était le démiurge, le grand ordonnateur, créateur tout-puissant. Il le sculptait de ses mots, généreux et amples. Le monde n’existait que par la grâce de l’écrivain. Il en résultait un roman-fleuve qui permettait de l’appréhender. Aujourd’hui, il semble que la littérature doive exister en tant que telle, sans référent à une quelconque réalité. Elle est désormais un écho à des instants de bonheur dont elle s’efforce de restituer l’intensité. Il ne faut guère en réclamer davantage : c’est déjà beaucoup. La littérature résulterait-elle d’une émotion ? Elle nous offre en tout cas à nous, lecteurs, des mots sublimes qui suscitent à leur tour nos émotions, et c’est ce qui nous les rend si précieux. Décidément, Olivier Rolin est un grand, un très grand. Il n’en finit pas de nourrir mon imaginaire et ma réflexion sur ce qu’est la littérature et les raisons de mon attachement à cette si belle matière. |
|
|
|
|
|