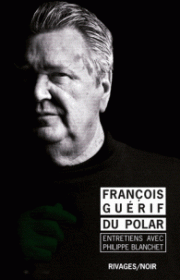i n t e r v i e w
François Guérif
« Je n’ai jamais publié un livre que je n’ai pas choisi »
Plus de mille titres au catalogue, de grands auteurs américains tels que James Ellroy, Tony Hillerman, Donald Westlake, James Lee Burke ou Dennis Lehane, mais aussi des romanciers de tous les horizons, notamment français… François Guérif, créateur et directeur de Rivages Noir depuis trente ans, a fait de cette collection de poche une marque de référence dans le polar, avant de suivre le même chemin, un peu plus tard, avec les grands formats. A 72 ans, avant de quitter à la fin de cette année les éditions Payot-Rivages (mais il continuera de s’occuper de quelques écrivains emblématiques), il revient pour o n l a l u sur les magnifiques « années noires » qu’il y a vécues…
Avant de rejoindre Rivages, vous avez démarré dans l’édition en solo…
J’ai lancé Red Label en 1978 en éditant notamment des inédits de Jim Thompson ou David Goodis. Le patron de la Série noire disait que je récupérais ses fonds de tiroirs. Sauf que, dans ces romans qu’il avait refusés, j’ai trouvé « La Lune dans le caniveau » (ndlr. adapté au cinéma par Jean-Jacques Beineix en 1983) … Dès ce moment, j’ai appliqué un principe que j’ai toujours défendu depuis : on ne coupe pas un texte. Les autres éditeurs estimaient alors qu’en poche, tous les livres devaient faire 150 ou 200 pages, même si l’original en comptait 400. Pour eux, c’était de la littérature populaire et il fallait des collections standardisées. Pour moi, ce sont des auteurs à part entière, que l’on respecte comme tels. Tous mes autres principes découlent de là…
Par exemple ?
La qualité de la traduction est essentielle. Un traducteur ne doit jamais accepter un texte qu’il n’aime pas. Il faut une osmose. Et si un traducteur se sent bien avec un auteur, pourquoi en changer ? Il devient sa voix, comme dans le doublage au cinéma.
Publier tous les textes d’un auteur est un autre de vos principes ?
L’édition est un travail de longue haleine et la relation avec un auteur, un partenariat. S’il est bon, si on croit en lui, on ne le laisse pas tomber dès qu’un de ses livres se vend moins bien. On l’épaule. Et le jour où il apporte un roman plus difficile, on le lui dit mais on le publie quand même.
Des regrets ?
Aucun. Sur 1040 titres, je n’ai jamais publié un livre que je n’ai pas choisi ou dont je ne voulais pas. Ce n’est pas le cas de tous mes confrères. Cela dit, ça n’a pas marché tout de suite. Un directeur de collection étant payé au pourcentage, je n’ai bien gagné ma vie qu’à partir de 45 ans ! Avant qu’une collection de poche soit rentable, il faut avoir un fond de catalogue qui tourne bien. Ça prend du temps. J’ai lancé les grands formats Rivages plus tard, pour « Le Dahlia Noir » de James Ellroy : vu son succès aux Etats-Unis, il était trop cher pour que nous rentrions dans nos frais en poche. Et nous ne voulions pas risquer qu’il parte chez un autre éditeur…
Depuis vos débuts, qu’est-ce qui a changé pour le lecteur de polars ?
L’offre est devenue énorme. Tous les éditeurs en font. S’ils ont une idée éditoriale, très bien, il y a de la place pour tous. Le drame, c’est que certains y voient juste un « marché porteur ». Les agents ont quinze propositions pour un nouvel auteur, les enchères montent. Et puis il y a une confusion des valeurs : quand le magazine « Lire » sélectionne ses « 10 meilleurs polars de l’année », dedans il y a trois merdes !
Pourquoi cet intérêt jamais démenti des lecteurs pour le roman noir ?
Ce sont des livres qui parlent d’eux, qui reflètent la société, ils s’y retrouvent. En plus, on leur expose le monde à travers une histoire passionnante, poursuite, enquête, énigme… « La Moisson Rouge », de Dashiell Hammett, sorti en 1927, est le roman fondateur du genre : des capitalistes engagent des gangsters pour éliminer des grévistes et comme les gangsters se trouvent bien dans ce monde, ils y restent. Si ça, ce n’est pas une métaphore de la société d’aujourd’hui…
Marier polar et fresque politico-sociale, c’est la marque de certains auteurs édités chez Rivages, tels que Dennis Lehane et James Ellroy…
Ellroy a dit qu’il voulait « écrire l’Histoire vraie de l’Amérique, qui est une histoire du crime ». Lui et Dennis Lehane montrent à quel point les gangsters font partie de cette Histoire… Et « Dino », la biographie de Dean Martin écrite par Nick Tosches, qui montre le rapport de la mafia avec le monde du spectacle, c’est aussi un roman noir. Un des plus beaux livres que j’ai publié. Cette collection ne comporte pas que de purs polars. C’est de la littérature noire, ce sont des écrivains à part entière et aucun lecteur ne m’a jamais demandé ce qu’ils faisaient là.

Comment avez-vous approché James Ellroy ?
Avant d’avoir l’occasion de le rencontrer, j’ai publié sa trilogie Lloyd Hopkins. Un agent m’avait fait parvenir « Lune Sanglante » (ndlr. premier volet précédant « A cause de la nuit » et « La colline aux suicidés ») et ce livre m’a tétanisé : aucun auteur n’avait jamais parlé de la violence de cette manière. Tous les éditeurs français ayant refusé le texte, l’agent, échaudé, voulait que je prenne les trois. Le patron de Rivages, Edouard De Andréis, trouvait que c’était trop cher, mais j’ai tenu bon. Et Ellroy a apporté tout de suite de l’oxygène à la collection.
Et votre première rencontre avec lui ?
Il est venu en France pour la sortie du « Dahlia Noir » en mai 1988. Je n’avais aucune idée du personnage, des bruits fantaisistes couraient sur lui. On est allé l’accueillir à l’aéroport et, pendant que Freddy Michalski, le traducteur, garait la voiture, j’ai pris un café avec lui. Il m’a tout de suite demandé : « Lequel de mes livres préfères-tu ? » On n’a parlé que de littérature… Et cela fait trente ans que cela dure. Ellroy est un génie, mais travailler avec lui n’est pas compliqué car il fait confiance. Il est fidèle et loyal si vous l’êtes avec lui. C’est quelqu’un d’attentif. Quand il a terminé un manuscrit, il l’envoie à trois personnes, dont moi. Là, j’ai intérêt à me manifester, car il veut absolument en discuter. Et pas juste pour s’entendre dire « Génial, James, super ! » On a une longue complicité, on a partagé des chambres d’hôtel, mais surtout, on parle de son écriture. C’est ce qui compte pour lui. Si l’Elysée l’invitait un soir où il a une séance de signatures prévue, il choisirait les signatures. Il se fout des honneurs, il vit comme un ermite, il est habité par son oeuvre. Au dernier jour du festival Quai du Polar, toute l’équipe des bénévoles s’est rassemblée à son départ pour l’ovationner. Il m’a glissé, presque les larmes aux yeux : « So much love ! »
Les romanciers américains sont sensibles à l’intérêt du public français ?
C’est important. Nous sommes le premier pays où a été reconnu le talent de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler. Un auteur comme James Ellroy vend deux fois plus de livres ici qu’aux Etats-Unis. Et tous ses titres continuent de bien se vendre, même ses recueils de nouvelles. Son « Perfidia » en est à 70.000 exemplaires, son « Underworld USA » à 100.000. On vend toujours 10.000 exemplaires par an du « Dahlia Noir », qui en totalise 600 ou 700.000… Il est entré dans l’histoire de la littérature. Quand je dis que, dans l’édition, il faut du temps, voilà ce que cela signifie.
Vous gardez du temps pour votre autre passion, le cinéma ?
Ma vie, c’est la lecture et le cinéma. Il n’y a pas de raison que cela s’arrête. Je continue à avoir envie de tout lire et de tout voir. Je suis plongé dans l’encyclopédie de Diderot, j’en suis au 9ème volume sur 15. Et depuis vingt ans, je regarde un film chaque matin. On a la chance que la technologie nous apporte ça à domicile, il faut en profiter. Mes journées ne sont pas assez longues, j’ignore ce qu’est l’ennui.
Propos recueillis par Philippe Lemaire
A voir : http://www.payot-rivages.net/video-Francois-Guerif
A lire : « Du polar », entretiens avec Philippe Blanchet, éditions Payot, 320 pages, 20€.