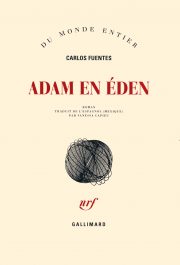|
Les internautes l'ont lu
coup de coeur
Une liberté de ton rare pour une critique des plus incisives
En ce début d’année 2015 nous a été proposé à la découverte l’un des derniers textes, à tous les sens du terme, d’un auteur qui reste prolifique et réjouissant au delà de sa disparition en 2012, le mexicain Carlos Fuentes. Adam Gorozpe est un avocat et homme d’affaire, très bien de sa personne, respecté, ayant fait un mariage « réussi » avec la fille du pape des gâteaux, Don Celestino Holguín. Respecté de ses collaborateurs… Enfin, peut-être conviendrait-il d’un peu relativiser. Pour commencer, que peut bien signifier le fait que lesdits collaborateurs portent maintenant tous des lunettes noires en sa présence? Ironie? Message? Nouveau conformisme aux clichés du cinéma? Mystère… Côté mariage, il est vrai que la relativement quelconque Priscilla est surtout remarquable par l’incohérence de ses propos, par sa compréhension limitée du monde et de ce qu’elle entend ou par son habitude à gifler la bonne sans raison apparente. Le fait qu’elle ait été un jour Reine du Printemps, courtisée aussi assidûment qu’une porte donnant accès à la fortune enviable de son père, n’arrange rien mais reste son heure de gloire. Dans ce monde Adam Gorozpe a fait son chemin, parti de peu pour arriver dans cette bonne société et y faire bonne figure. Don Celestino le reconnaît et apprécie. « Comme tu as bien choisi, Priscilla. Qui aurait cru que ce crève-la-faim que tu as épousé serait mille fois plus riche que moi, son beau-père, et tout ça à la sueur de son front? – Mais mon papounet, le pain ça ne sue pas » intervient cette inconsciente de Priscilla avant de recevoir un jus de pastèque des mains de la domestique, qu’elle remercie d’une bonne gifle. Mais don Celes avait déjà tourné le nord de son attention vers l’autre convive, son fils Abelardo. « Et toi Abelardo, pourquoi n’es-tu pas comme ton beau-frère? Pourquoi ne l’imites-tu pas rien qu’un peu, dis? » Tout va cependant à peu près bien pour Adam, jusqu’au jour où apparaît Adam… Adam Góngora, l’éminence noire des milieux du pouvoir. Cet Adam là, est aussi laid et peu soigné de sa personne que le premier Adam est soigné et élégant. Il pue de la gueule, au propre comme au figuré, mais a irrésistiblement séduit l’ordinaire et imprévisible Priscilla. La vie d’Adam Gorozpe pourrait bien basculer face à son homonyme maître ès mensonges et menaces voilées, parfait artisan d’une police de classe qui nourrit et organise un simulacre de justice, attentive à défendre les intérêts de ses maîtres en attendant de prendre leur place. Derrière la farce et le ridicule, il y a bien quelque chose de pourri au royaume du Mexique et les gâteaux de don Celestino ont un goût un peu trop rance. La comédie féroce se fait aussi analyse historique et socio-politique. « Notre pays est un pays de fortunes récentes. Peut-être à l’époque coloniale le clergé et les propriétaires terriens se sont-ils partagé le gâteau sous prétexte de garnir notre table. Mais après l’indépendance, la table avait perdu ses pieds. Sans la protection de la Couronne espagnole, la nouvelle république s’est transformée en, comme nous l’appelons chez nous, rosaire d’Amozoc, donnybrook, chienlit, bordel, ou, pour le dire en argentin, quilombo, un orchestre sans autre musique que le tempo marqué par la jambe de bois du dictateur Santa Anna. Juárez et les libéraux ont vaincu l’ordre conservateur, l’empire de Maximilien et l’occupation française. Depuis lors, le Mexique lutte pour concilier l’ordre et le mouvement, les institutions et l’expansion. Je me dis et je mendie (je me dis mendiant), les millionnaires de mon enfance étaient presque des miséreux par rapport aux millionnaires d’aujourd’hui, mais ces derniers cohabitent avec une société très diverse, nombreuse, plus de cent millions d’habitants qui luttent pour s’en sortir et trouver leur place au soleil, coûte que coûte. (…) Non: ce qui est vraiment mauvais, pervers, terrible, c’est la nouvelle classe criminelle qui est en train d’usurper les pouvoirs petit à petit, à la frontière, puis en allant vers l’intérieur. Le flic illettré d’abord, le politique éclairé ensuite, tout ça sans intermédiaire personnel: d’où sortent-ils ces nouveaux criminels? Ils ne sont ni paysans, ni ouvriers, ni de la classe moyenne, ils appartiennent à une classe à part: la classe criminelle, née, comme Vénus, de l’écume de la mer, de l’écume d’une bière chaude renversée dans un troquet minable. Ce sont les enfants de la comète. Ils corrompent, séduisent, font chanter, menacent et finissent par s’emparer d’une commune, d’un Etat, un jour du pays tout entier… Ce qui est malheureux, c’est qu’il faut parfois, pour un résultat heureux, avoir recours au pire. Et c’est ce qui m’arrive maintenant. » Et quand cela arrive, on peut faire de drôle de choses, à en perdre le nord, à ne plus se reconnaître, à agir et parler à l’envers et à dire n’importe quoi… ce qui n’est pas toujours sans conséquences… On le comprend, Carlos Fuentes a fait du rire une arme qui est bien loin de la moquerie ou du sarcasme et qui pourtant n’épargne personne. La farce cruelle n’est cependant pas sans bienveillance dans sa férocité à l’égard des dérapages bien peu contrôlés d’une société qui n’est pas que mexicaine, loin s’en faut. Le récit et l’écriture jouent avec nous, rebondissant de voix en voix, le narrateur s’adressant parfois au lecteur puis replongeant dans son histoire en passant la parole à un autre narrateur, au point que l’on s’y perdrait presque. Mais ne nous inquiétons pas, ce n’est après tout qu’un livre, et l’auteur est attentif à ce que nous ne l’oublions pas. Un livre qui s’écrit et que l’on lit, que d’autres écrivains peuvent même commenté, comme l’argentin Tomás Eloy Martínez et le nicaraguayen Sergio Ramírez, tout en dissertant sur la littérature, le cinéma et la lecture. – « Dis-moi, Sergio, dans la littérature on peut vérifier une identité comme au cinéma: ce monsieur qui dit être Domingo Sarmiento est en réalité l’acteur Enrique Muriño? – Non: Raskolnikov peut être Peter Lorre ou Pierre Blanchard, mais ni Lorre ni Blanchard ne peuvent être Raskolnikov. Ils sont image. Raskolnikov est mot, syllabe, nom, littérature… – Nous imaginons la littérature et nous ne faisons que voir le cinéma? – Non, nous donnons à la littérature l’image que nous souhaitons. – Pas au cinéma? – Seulement quand les lumières s’éteignent et que nous fermons les yeux. (…) – Et tout ça, qu’est-ce que ça a à voir avec le roman que tu es en train de lire? – Tout et rien. Les mystères associatifs de la lecture. – Le besoin de retarder le dénouement? – Il n’y a pas de dénouement. Il y a la lecture. Le dénouement, c’est le lecteur. – Le lecteur recrée ou invente le roman? – Un roman intéressant échappe à l’écrivain, plutôt… » Les personnages et le lecteur sont un peu comme la balle d’un flipper social et littéraire, le but du jeu étant de rester dans la partie , à rebondir de tous côtés, pour retarder autant que possible la sortie de jeu finale. S’il en existe une pour le premier homme, le premier Adam tombé en Eden. Mais peut-être les lecteurs et lectrices seront-il, seront-elles ces premiers humains tombés en cet Eden littéraire… qu’il leur appartiendra de dénouer! Retrouver Marc Ossorguine sur son blog |
|
|
|
|
|