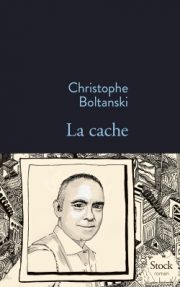|
La rédaction l'a lu
Bienvenue chez les BoltDans la famille Boltanski si vous demandez le fils, vous en aurez trois. Et des plus brillants. Christian, l’artiste plasticien ; Luc, le sociologue ; Jean-Élie, le linguiste. Il y a aussi une fille, Anne. Elle est photographe. Christophe, l’auteur de ce roman – fils de Luc- est journaliste, grand reporter. Dans cette étincelante lignée, c’est lui qui a mis en mots, avec force et pudeur, une histoire familiale des plus originales. Il nous fait littéralement pénétrer au cœur d’un cocon savamment tissé par une dévorante, mais fascinante reine mère : « Elle nous avait tous avalés (…/…) Nous étions devenus ses bras, ses jambes, une prolongation de son propre corps ». Celle qui se faisait volontairement appeler « Mère Grand » – comme un défi aux grands méchants loups- était handicapée des jambes par une polio qui l’avait frappée dans les années 30. Aussi séductrice qu’intimidante, c’est sans réserve qu’elle assumait ses choix de vie, même les plus extravagants. C’est la figure majeure de ce livre, l’étoile la plus scintillante de la galaxie Boltanski, l’origine de leur monde si singulier, mais si créatif aussi. L’auteur aurait d’ailleurs pu intituler ce roman « Le livre de ma grand-mère », tant l’hommage qu’il lui rend est flamboyant. Christophe Boltanski nous invite dans son texte comme il le ferait au seuil d’une maison. La première page est le plan dessiné d’une cour d’immeuble. Tel un propriétaire, il nous donne un droit de visite ou plus ludique encore, il nous invite à une partie de jeu de plateau. Ce plan est celui d’un hôtel « très » particulier de la « Rue-de-Grenelle » à Paris, où vécurent Étienne et Myriam Boltanski entourés de leurs proches : enfants et petit fils (Christophe, le narrateur à l’âge de 13 ans décida de vivre chez ses grands-parents). À la lecture des premières pages, on pourrait penser qu’ils y sont reclus, mais ils étaient avant tout soudés : « Main dans la main, collés les uns contre les autres, nous formions un seul être, une espèce de gros mille patte ». Ce plan, élaboré de la cour jusqu’au grenier en passant par les étages, va architecturer le récit, rythmer ses différentes parties et nous guider à travers le fabuleux destin de cette famille pas tout à fait comme les autres. Chez eux tout est paradoxal : ils ont une vaste demeure et des moyens, mais vivent comme des clochards (sans se laver et se nourrissant de conserves); ils ne sortent jamais à pied, toujours en voiture, même pour de courtes distances; ils assistent à la messe, mais sans rentrer à l’intérieur de l’église ; ils voyagent au bout du monde, mais sans faire de visites touristiques; les enfants doivent être instruits sans avoir été à l’école; le grand-père est médecin mais, hyper-sensible, il perd connaissance à la vue du sang. Et bien d’autres bizarreries encore. Pour tenter de comprendre cette vie fantasque et foutraque, Christophe Boltanski va remonter le fil du temps et nous raconter l’origine de ces comportements plus qu’étranges. Ils résultent principalement du double traumatisme subi par Étienne le grand-père. Après avoir survécu à la boucherie de 14-18, il dut se cacher pendant la seconde guerre mondiale durant vingt mois chez lui, dans un réduit. Il était juif converti au catholicisme. Pour échapper à la déportation, sa femme, intuitive, lui avait sommé de ne pas céder aux injonctions administratives de Vichy. C’est ainsi qu’elle lui sauva la vie en faisant croire aux autorités collaborationnistes que son mari l’avait quittée et avait divorcé, alors qu’elle le cachait chez eux à l’insu de leurs proches . De là, face à la réversibilité de l’être humain durant la guerre qu’elle combattra sans relâche, elle fit sienne la devise « le pire est toujours sûr ». Et elle transmit cette phobie en héritage. Elle décida de vivre entourée des siens, sans cesse aux aguets, dans la peur incessante de les perdre, même en temps de paix. Elle ne détruisit jamais la cache. Qui sait, elle pourrait resservir. Et puis il y a en arrière-plan son passé traumatique à elle, la grand-mère. Prénommée Myriam, née Marie-Élise dans un milieu défavorisé, elle fut abandonnée puis adoptée par une riche veuve catholique. Un parcours de vie très atypique, lui aussi entre-deux, avec tout un pan caché. L’auteur nous cite une phrase de Daniel Mendelsohn dans « Les disparus »: « Si vous n’aviez pas une histoire étonnante, vous n’auriez pas survécu ». Et bien Christophe Boltanski a fait de cette histoire plus qu’étonnante, un formidable premier roman tout en générosité, qui démontre qu’il n’y a qu’un seul choix possible: la liberté. Celle de vivre comme on l’entend, d’inventer son propre espace, même fermé. Ce qui a été pour eux le creuset d’une puissante créativité. Le choix des Boltanski.
Les internautes l'ont lu
Sentiments partagés
Un livre primé par le Femina dont on a beaucoup parlé de manière positive. J’avais envie de le lire depuis sa parution et je remercie les éditions Stock et Netgalley pour ce partenariat. J’en attendais peut-être trop, allez savoir, mais à la fin de la lecture, une semaine plus tard, je suis partagée. Partagée car l’idée est géniale, tout comme la construction du roman. Pièce par pièce – à commencer par en préambule, la voiture considérée pièce à part entière – comme un Cluedo géant, nous allons partir à la découverte de la famille BOLTANSKI, en cherchant par des indices déposés ci et là quelle est leur identité et qui ils sont vraiment. L’idée est de décrire l’appartement familial au départ de chaque chose qui le compose, chaque objet ramènant à un morceau de l’histoire de cette famille au destin particulier. J’ai beaucoup ressenti l’importance des objets en pensant justement à la lecture de « Les Choses » de Georges Perec. Un vocabulaire riche et imagé nous fait parcourir chaque objet retraçant l’histoire passionnante de la famille. Cela fonctionne très bien mais là où cela a cessé de fonctionner pour moi c’est lors de l’utilisation de ‘il’ ou ‘elle’, et aussi lors d’incessants allers-retours dans le temps et entre les personnages. Tout cela m’a perdue, ne sachant plus très bien de qui on parlait et à quelle époque on était. J’ai arrêté la lecture un moment pour faire une recherche sur le net afin de mieux structurer les Boltanski, chacun ayant pris des identités multiples ce qui ne simplifia pas la tâche. Il est vrai que la recherche d’identité est le thème majeur du récit et petit à petit les pièces du puzzle s’imbriquent l’une dans l’autre mais un arbre généalogique n’eut à mon sens pas été superflu. En remontant aux racines de ses ancêtres, ce sont de véritables pans de l’Histoire, des thèmes majeurs qui sont parcourus : les pogroms, le drame de la judéité, les déportations, le régime de Vichy et la réinsertion. L’écriture est riche, agréable manquant par moments pour moi d’émotions. Est-ce de la pudeur ou ai-je plutôt eu le sentiment d’avoir lu un point de vue de reporter, je l’ignore. J’ai lu certains passages à voix haute au départ. La langue sonnait d’autant plus que la beauté du texte était d’une magnifique musicalité et lui apportait plus de profondeur. En conclusion ne vous méprenez-pas, ce Prix Femina ne m’a pas laissée indifférente. A lire pour se forger sa propre opinion. Ma note : elle est sévère 7/10 Les jolies phrases En s’unissant à lui par un mariage qui la coupait de son milieu, elle avait tout épousé : ce qu’il était et ce qu’il ne voulait plus être. Odessa se comporte un peu comme un ordinateur qui ne cesse d’accumuler des coordonnées et, dans le même temps, de nettoyer sa carte mémoire. Odessa est une ville juive sans Juifs. En tout cas sans Juifs d’ici. Il ne changera pas de religion, il en adoptera une. De son passé de soldat, il gardait un immense dégoût. Il savait maintenant de quoi l’homme était capable. Les rues sont ainsi peuplées d’êtres qui déjà ne sont plus, mais moi, je ne peux subir ma destruction. Être vieux, écrit-elle encore, ce n’est plus vivre, mais attendre l’inexorable. Ma famille ne vivait pas recluse mais soudée. Tel un cauchemar qui la poursuivait jusque dans son exil. Je ne sais pas si elle a déchiré un jour le voile enchanteur de ses souvenirs. Sa peur de la foule, de ce brusque déchaînement de violence collective, elle l’a transmise, en tout cas, à son fils et au-delà. L’enfermement favorise-t-il la créativité ? L’imaginaire se développe-t-il plus aisément dès lors qu’il n’est pas confronté au réel ? Retrouvez Nathalie sur son blog
nuit blanche
La cache… où se trouvent tous les Boltanski
«En près d’un siècle, ce récit a dû être raconté quelques dizaines de fois, par un nombre limité de personnes, cinq ou six, au maximum. Avec le temps, il a acquis la force d’une légende, d’une fable débarrassée de ses défauts, lissée par des années de manipulation. Il s’est durci, comme de la pâte à modeler. Il a fini par se dessécher puis devenir friable. Je me dépêche de le transposer sur le papier avant qu’il ne s’émiette et ne disparaisse à jamais. Il renferme évidemment une part de vérité. »
coup de coeur
Le roman captivant d’une tribu singulière.
Passionnant, intelligent, remarquablement construit : ce roman m’a captivée. Peut-être parce que la famille Boltanski – ou faut-il parler de tribu ? – porte en elle des gènes éminemment romanesques. Peut-être aussi parce que l’auteur utilise ici son savoir-faire d’excellent journaliste reporter pour mener l’enquête et tenter de restituer l’alchimie subtile qui a abouti à la construction de cette famille hors du commun. Sûrement également parce que l’idée de faire parler les murs de la maison qui les a abrités (et le mot est ici particulièrement juste) permet d’aboutir à un résultat aussi original que séduisant. C’est donc à une visite que nous convie Christophe Boltanski. Celle de la maison de ses grands-parents, rue de Grenelle. Etienne et Marie-Elise, appelée aussi Myriam mais on verra que la question de l’identité est assez centrale dans ce livre. Un fils d’émigrés juifs russes ayant fui les pogroms à la toute fin du 19ème siècle et une fille de famille de la bourgeoisie bretonne, offerte en cadeau à une parente isolée pour lui servir de fille et d’héritière. Un couple soudé, que rien ne séparera, ni les guerres, ni la polio contractée par Marie-Elise à trente ans et qui la laissera définitivement handicapée. Un couple qui envisage sa maison comme un cocon qui les isole de l’extérieur et les protège. De pièce en pièce, l’auteur redonne vie à cette famille, faisant surgir des scènes, des dialogues, des instants de vie et des moments de drame. Il compare son travail d’enquête au jeu du Cluedo, petit clin d’œil à la difficulté souvent rencontrée pour reconstituer l’histoire, ainsi qu’aux secrets qu’ont parfois abrités les pièces. Car si le couple ressent le besoin de créer un refuge, c’est qu’il y a danger (l’antisémitisme, puis les rafles pendant la guerre) et Etienne, bien que converti au catholicisme dans les années 30 reste dans le collimateur des occupants en 1943. Une période évoquée lorsqu’on arrive à la petite pièce baptisée « entre-deux » dans laquelle une cache a pu être aménagée, permettant à Etienne, empêché d’exercer la médecine et menacé d’arrestation de se cacher jusqu’à la libération de Paris. On est à la fois époustouflé par la curieuse manière de vivre de la tribu Boltanski (enfants déscolarisés, désir tellement fort de ne pas être séparé que tout le monde dormait dans la même pièce, peu d’attention accordée aux repas ou au ménage…) et curieux de constater comment ce climat, véritable terreau de créativité a abouti à générer autant de talents intellectuels et artistiques (Luc, sociologue et Christian, plasticien sans oublier l’activité littéraire de Marie-Elise elle-même). Et puis il y a cette question de l’identité, un fil rouge qui donne sens à ce roman. Car l’auteur s’interroge sans cesse sur la réalité de ces gens qui forment sa famille et dont les origines sont sans arrêt remises en question. C’est ce qui arrive lorsque l’on doit fuir, maquiller son identité pour échapper au pire. Fausses identités, fausses déclarations, faux certificats… A quoi se fier ? Aux romans écrits par sa grand-mère, hautement autobiographiques ? Mais dans quelle mesure ? J’ai pris un énorme plaisir à cette visite riche en émotions et en images sur pratiquement un siècle. Depuis la Fiat 500 où tout le monde s’entassait (toujours pour éviter d’être séparés) jusqu’au salon, théâtre de la vie sociale de cette famille pas comme les autres, en passant par les lieux plus intimes (chambre, salle de bains, bureau) propices à creuser plus avant les caractères et les personnalités de chacun. Sans oublier le grenier et ses jeux d’enfants. Mais c’est peut-être la visite de la cuisine qui m’a le plus touchée avec cette réflexion qui relie identité et nourriture. « Elle qui ne mangeait rien nous transmettait une tradition culinaire pour solde de tout compte. Pas de folklore exotique, pas de coutumes à respecter, pas de langue rare à sauver de l’oubli, pas de culture ancestrale à entretenir par-delà les frontières. Juste des recettes. Une nourriture qu’il fallait qualifier de « russe » pour ne pas dire juive. » Passionnant, intelligent, remarquablement construit. Quoi ? Vous n’êtes pas encore chez votre libraire pour en quérir un exemplaire ? |
|
|
|
|
|