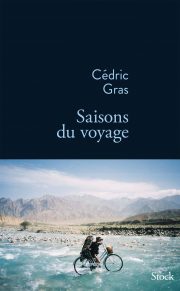J’ai seize ans, je suis en Première littéraire et je découvre L’antivoyage de Muriel Cerf : la claque. L’envie de partir, d’aller où le vent me mènera. Je n’irai nulle part. Je passerai mon bac, poursuivrai mes lectures et découvrirai Alexandra David Néel (lue et relue), Nicolas Bouvier, Annemarie Schwarzenbach.
Plus tard Sylvain Tesson, cet été le magnifique Hautes solitudes. Sur les traces des transhumants d’Anne Vallayes.
Là, je viens de finir Saisons du voyage. Et de nouveau, s’empare de moi cette sensation qui s’apparente à de la faim ou plutôt à de la soif. L’impression de se balader le long d’un cours d’eau bien frais un jour de grande chaleur. Juste une envie : se jeter dedans !
Je tiens ça de mon père qui, jusqu’à ce qu’il finisse par se paumer dans des rues qu’il connaissait par coeur à cause de sa maladie de m—- , passait tout son temps à marcher. A peu près n’importe où.
Heureux dehors.
Ma sœur est pareille. Mon frère serait bien aussi dans le même genre. Maintenant que j’y pense, ma mère aussi.
C’est de famille.
Saisons du voyage dit à quel point partir est un besoin vital. « Demain ne pouvait que se trouver ailleurs. » L’auteur, étudiant en géographie, ne tarde pas. Il part. Il part car il s’ennuie. C’est lui qui le dit. Peu importe la destination au fond. Ce qui compte, ce sont les paysages traversés. Ils s’accompagnent d’une terrible prise de conscience : plus rien n’est à découvrir. Tout a été vu, revu, photographié. Il ne reste plus qu’à marcher « sur les traces de ». Terrible constat : il est arrivé trop tard. Il ne peut que ramasser « les miettes du grand festin de l’exploration ». Sa génération doit se contenter de « lambeaux d’aventure ».
Sans compter que le tourisme de masse et la modernité viennent ternir encore davantage le tableau. On le sent un peu dépité notre Cédric ! Il s’en remettra. Il comprendra qu’on voyage à un instant T et que le monde qui nous est offert à ce moment-là est le nôtre et qu’il faut le prendre comme il est. Pourquoi en vouloir un autre ? Pourquoi toujours penser à ce qu’il y avait avant ? On appartient à une époque. On n’a pas le choix. Oui, maintenant on peut se rendre au Tibet « en wagon pressurisé ». Eh bien, allons-y quand même. Je comprends bien l’amertume de celui ou de celle qui aurait voulu y aller déguisé(e) en mendiant(e). Mais Alexandra David Néel serait, je crois, la première à nous inviter à la sagesse, à la contemplation de nos voisins de compartiment, à leur façon de manger, de dormir, de s’occuper d’eux-mêmes ou de leurs enfants.
« À Luang Prabang, il aurait fallu venir dix ans plus tôt. À La Paz les jeux sont faits. À Iguazu nous sommes des milliers. Je suis un voyageur en retard. »
On sent, dans les premières pages du livre, du dépit, de la colère même peut-être. Parce que le tourisme « proscrit la rencontre et folklorise le dépaysement », parce que le tourisme « ne peut s’immerger dans les lieux qu’il submerge », parce qu’en un mot, il « se moque du monde. »
Mais par la suite, j’ai eu le sentiment, en avançant dans ce récit, que Cédric Gras avait pris conscience qu’au fond, en faisant juste un pas de côté, on pouvait avoir le sentiment d’être seul, enfin dans un lieu où aucun touriste ne va : il suffit « d’éviter les incontournables, les tropismes communs, Ushuaïa, la vallée de Khumbu… », il faut « tracer des perpendiculaires aux circuits des superlatifs, ne pas s’émouvoir à l’unisson de ses pareils. »
Un simple pas de côté, vers un monde « absent de nos écrans, de nos ondes radio, du creux de nos assiettes » par exemple ! Aller là où les gens vous demandent pourquoi vous êtes là, bien persuadés qu’il n’y a pas grand-chose à photographier chez eux.
Pas si difficile que ça finalement. Car, à mon avis, ils sont bien nombreux, les lieux où personne ne va.
Et puis, si c’est possible, ajoutez à cela un petit décalage temporel : « Je me déplace avec les saisons, pas les périodes touristiques et les calendriers décrétés par les ministères, mais celles de la mécanique céleste. »
Et le tour est joué !
Au fond, la sagesse ultime, n’est-ce pas, finalement, accepter d’explorer « SON monde » c’est-à-dire, le monde tel qu’il est dans l’époque qui est la nôtre.
Saisons du voyage est l’histoire, me semble-t-il, d’un itinéraire spirituel, le récit d’une acceptation, celle qui consiste à regarder le monde dans lequel on vit avec ses brouillards de pollution, ses objets en plastique fluo, ses touristes à appareils photo, ses autoroutes infinies, son uniformisation-rouleau-compresseur et à l’accepter tel qu’il est. Je repense soudain à la façon dont Apollinaire dans « Zone » intègre, à sa poésie, le quotidien de son époque : Tour Eiffel, automobiles, enseignes, plaques, journaux, aéroplanes. Oui, c’est cela, Saisons du voyage est l’histoire d’un cheminement vers une forme d’adhésion à ce qui fait notre époque, qu’on le veuille ou non. « Je m’étais vu explorateur, au temps du bureau des Longitudes à l’intitulé si extraordinaire. Je suis devenu un simple voyageur emporté par la vitesse des transports, autour d’une planète rétrécie et uniformisée sous l’hégémonie des plus forts. Je n’en suis pas moins comblé, je ne me suis même jamais véritablement senti floué par l’époque. C’est dans ce monde-là que je me suis plongé la tête la première, pour feuilleter les pages de l’humanité dissemblable ou clonée, déchiffrer les sociétés en éruption et disséquer les pays anesthésiés. Voilà tout le voyage aujourd’hui. Lire le monde, partout, quel que soit ce qu’il nous raconte, observer les yeux grands ouverts. Le regard : la vraie définition du voyage. »
C’est un homme « résigné » qui termine l’écriture de ce livre magnifique (et je ne vous ai pas parlé des mille lieux évoqués dans une prose poétique ciselée), « résigné » dans le sens d’apaisé car enfin en accord avec le monde qui est le sien, SON monde, peut-être un homme qui a mûri, qui n’est plus l’enfant qu’il était lors de ses premières escapades, mais quelqu’un qui a compris que le passé appartient au passé, que lui marche dans le présent et que ce présent, si on veut bien le regarder en face, révèle ses beautés à qui est capable de les voir. Un homme qui a compris qu’il ne pourra jamais tout contempler, parce qu’il est humain, qu’il n’a plus vingt ans et que certaines terres lui resteront à jamais inaccessibles.
« Résigné » et heureux.
Capable, un soir d’été, de se laisser porter par la mer « sous la voûte scintillante et démesurée », de contempler le ciel et d’avoir le sentiment profond d’être là où il doit être.
La sagesse ? Oui, ça s’appelle peut-être comme ça …
Retrouvez Lucia Lilas sur son blog