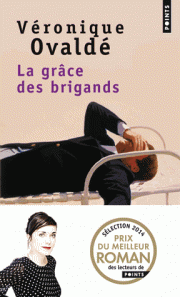|
Quelle lectrice êtes-vous, Véronique Ovaldé ?
Véronique Ovaldé a toujours lu. Dévoré même. Aujourd’hui encore, elle se nourrit des livres des autres, s’en inspire, enrichit son imaginaire de toutes sortes d’expériences littéraires. Et lorsqu’on connaît son œuvre, ce qu’elle nous raconte sur les sources de son inspiration ne nous étonne pas du tout.
Quels sont vos premiers souvenirs de lecture ? Je me souviens surtout d’avoir eu très peur, juste avant d’entrer en CP, de ne pas réussir à lire. Que ce serait quelque chose qui n’existerait pas pour moi. C’est un sentiment d’ailleurs qu’aujourd’hui encore j’éprouve souvent avant de me lancer dans quelque chose. Et puis après, ça marche tout seul. J’ai aussi le souvenir d’avoir écrit des histoires toute petite. Lisait-on beaucoup dans votre famille ? Nous n’avions quasiment pas de livres à la maison, mais ma mère a toujours beaucoup lu. Tout ce qui lui tombait sous la main, des Harlequin en même temps que « Voyage au bout de la nuit » de Céline. Elle était, et est toujours, une lectrice qui ne cherche pas autre chose que du divertissement, de l’évasion. Mais du côté de mon père, la lecture était considérée comme quelque chose d’assez dangereux et subversif. J’ai beaucoup lu à la bibliothèque municipale. Et très vite, mes goûts se sont portés vers les contes, puis la science fiction. Les bibliothécaires me laissaient choisir ce que je voulais, même des romans pour adultes, mais à la maison, mon père censurait nos lectures. Que choisissiez-vous parmi la littérature pour adultes ? Ce que l’on m’interdisait justement! Norman Mailer, Tennesse Williams, qui parlaient beaucoup de sexe, et de la marge, avec des personnages désespérés, alcooliques. Cela me fascinait. Et je continuais à écrire, des petits romans de 200 pages. Comment expliquez-vous cette passion pour la lecture ? Le fait de vouloir absolument sortir de là où j’étais. Comme beaucoup d’enfants, j’étais persuadée d’avoir été adoptée à la naissance. J’avais l’impression d’être quelqu’un de différent. Ma sœur et moi étions très férues de lecture. Cela nous donnait la possibilité de mettre un pied hors de cette enfance cadenassée. La littérature nous offrait la possibilité de sortir sans sortir! Et en plus, je me sentais très encombrés par mon imaginaire: j’étais toujours en train de converser avec tout un tas de personnages. J’écrivais tous les jours. Il était évident pour moi que je deviendrais écrivain. Quels sont vos grands souvenirs de lecture ? J’ai été « biberonnée » à la littérature américaine, celle du 20e siècle. Le théâtre de Tennessee Williams que j’ai adoré. Hemingway, Faulkner. Je n’ai probablement rien compris à son roman « Le bruit et la fureur », mais je percevais que c’était un magnifique texte de poésie. Puis vers 16 ans, j’ai découvert les Sud-Américains, avec Garcia Marquez. J’ai relu récemment quelques pages que j’avais écrites à l’époque, j’étais déjà fascinée par les brigands, les personnages extravagants, j’avais ce goût pour l’onirique, le petit pas de côté vers l’étrange. Tout était en germe et cela m’a beaucoup troublée. Les lectures d’enfance sont fondamentales, elles forment le terreau de notre imaginaire. Après votre bac, que décidez-vous de faire ? Il n’y a pas d’écoles pour écrivains… Au lycée, j’ai choisi la session artistique. Au moment du bac, j’ai hésité entre le dessin et l’écriture. Faire les deux me semblait incompatible. Je sentais qu’il fallait que je mette toute mon énergie dans une seule chose. A 18 ans, j’ai complètement abandonné le dessin. Lire, c’était et cela reste une façon d’apprendre à écrire. Je lisais les Sud-Américains, les Japonais, et beaucoup de poéie, Baudelaire, Apollinaire. A l’époque, je suis tout le temps en train de lire. Je ne sors pas, je ne fais que lire et écrire. Et mon souci est de savoir comment je vais réussir à me faire publier. J’ai l’impression de ne pas me trouver au bon endroit, de ne pas évoluer dans le bon milieu. Je crois que c’est en partie pour ça que j’aime tellement la littérature américaine. Les Américains, ce sont des gens qui n’ont pas besoin de venir d’un milieu trop bourgeois, d’avoir suivi de longues études. Il y a cette espèce de fantasme que tu peux réussir quel que soit l’endroit d’où tu viens. Mais vous réussissez à entrer dans l’édition. Après mon bac, je décide donc de faire un BTS d’édition. Une manière de pénétrer dans le château-fort. Je commence au Seuil, au secteur fabrication, où je travaille pour les éditions de l’Olivier et Christian Bourgois, un dieu vivant pour moi, ainsi que pour d’autres maisons. C’est un apprentissage génial, mais je ne perds pas de vue que tout cela, c’est pour réussir à publier mes textes… Je donne « Le sommeil des poissons » à Louis Gardel qui se montre enthousiaste et le publie. Malheureusement le livre tombe au fond d’un trou dès que qu’il paraît. Le suivant, « Toutes choses scintillant », sort dans une petite maison, l’Ampoule et est remarqué. Puis malheureusement l’ampoule s’éteint, je suis publiée ensuite par Actes Sud, et enfin par les éditions de l’Olivier. Aujourd’hui, avez-vous l’impression d’être arrivée à bon port ? Je sais une chose, c’est qu’il m’est impossible d’arrêter d’écrire, même si personne ne me lisait plus. Lisez-vous lorsque vous êtes en période d’écriture ? Il est très important pour moi d’être sous influence. Je me garde des livres d’avance, comme ça je sais que ça va être de la bonne nourriture. Je lis beaucoup de livres en même temps. Des Américains, des Sud-Américains, des Français. Je lis mes amis, par curiosité mais aussi par goût. J’adore les rentrées littéraires lorsque je n’y suis pas, parce qu’elles sont pleines de promesses et de trésors. Vous arrive-t-il d’être jalouse de ce que vous lisez ? Jamais. Lorsque j’ai découvert « Qu’avons-nous fait de nos rêves? » de Jennifer Egan, il y a deux ans, alors que je voulais écrire depuis longtemps un livre avec tout un tas de personnages qui se répondraient sur différentes époques, mais qu’il me manquait le temps et la disponibilité d’esprit pour y parvenir, quand j’ai vu donc qu’elle, Jennifer Egan, avait réussi, j’ai été à la fois admirative et très heureuse. Heureuse, car j’allais pouvoir m’en imprégner, et voir comme ça se goupille. Je suis un peu comme un architecte qui examine un bâtiment. Je suis toujours intéressée par la fabrication d’un récit, la manière dont l’écriture se déploie. C’est la raison pour laquelle j’aime tout lire d’un écrivain, assister à son évolution. Il m’arrive d’ailleurs souvent de ne pas terminer les livres. Je peux m’arrêter vingt pages avant la fin, je me fiche de savoir comment ça se termine. C’est la façon dont on mène un récit qui m’intéresse. Il y a, dans la lecture, quelque chose de terriblement consolateur. Consolateur de soi, de sa vie, de la nature humaine, de sa nature périssable. Quels textes vont ont consolée ? Deux m’ont sauvé la vie à deux moments difficiles. « La course au mouton sauvage » de Haruki Murakami. Je ne pouvais plus lire, je n’arrivais plus à me concentrer. C’était son premier texte publié en France. Il était tellement libre. Et puis « La maison des feuilles » de Mark Danielewski, dont la structure, l’intelligence, le côté labyrintique m’ont éblouie. Et le troisième livre important, même s’il ne m’a pas sauvée parce que je n’en avais plus besoin, c’est « 2666 » de Roberto Bolagno. C’est un texte inachevé, que je relis souvent. Comme je le dis à mes enfants, et comme le disait Montesquieu avant moi, aucun chagrin ne résiste à une heure de lecture!
Où, quand et comment ?
Où et comment lisez-vous? N’importe où et rarement autre chose qu’un livre. Chez le docteur, dans le métro, dans un bistrot. Partout, dès que j’ai deux minutes. Si je n’ai pas de livre, je me sens seule. Marque-pages ou pages cornées ? En général un crayon, car j’écris dans la marge, je souligne. Autrement, je mets n’importe quoi, un ticket de métro. Corner sert à autre chose, à me souvenir d’un passage, d’une page que j’aime. Bruit ou silence ? Je ne peux pas écrire avec le moindre bruit. Il me faut du silence et des boules Quiès. Mais je peux lire n’importe où et « m’absenter » sans problème. Jamais sans mon livre ? C’est la première chose que je prépare le matin avant de partir de chez moi. Et aussi la première chose que je mets dans ma valise lorsque je voyage. Un seul à la fois ou plusieurs ? Plein en même temps. J’adore qu’il y ait une espèce de confusion entre mes lectures. Dans le métro par exemple, je ne prends pas les plus gros, plutôt des poches. J’en ai un autre pour le soir. Je me sens très libre avec les livres. Il n’y a pas de sacralisation. Et autant dire qu’ils ne sont pas en très bon état à l’arrivée, ils sont tout gribouillés, et la dernière page est en général entièrement recouverte de notes. C’est pour ça que j’aurai du mal à passer à la tablette, car le livre me sert à beaucoup d’autres choses que lire. Combien de pages avant d’abandonner ? Ça peut être très peu! Cinq pages par exemple. Je sens vite si ça va me plaire ou pas. J’abandonne si c’est mal traduit, si la langue ne me plaît pas, s’il y a trop de clichés enfilés sur le même collier.
La petite ordonnance du Dr. Ovaldé
« Chroniques de l’oiseau à ressorts » de Haruki Murakami « Alcools » de Guillaume Apollinaire « 2666 » de Roberto Bolagno « L’amant de Lady Chatterley » de DH Lawrence « Tristes revanches » de Yoko Ogawa « Le manuel des inquisiteurs » d’Antonio Lobo Antunes « Confiteor » de Jaume Cabré Lire notre chronique de « La grâce des brigands »
|
|
|
|
|
|